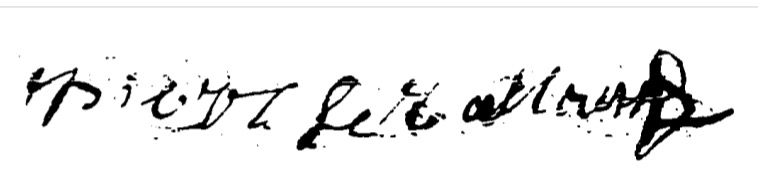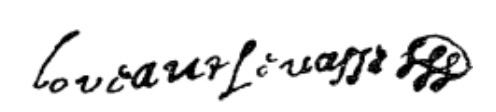Principaux ancêtres Levasseur
Au 17e siècle, des personnes portant le patronyme « Levasseur » ont quitté la France, leur terre natale, pour venir en Nouvelle-France. Jean, Pierre et Laurent Levasseur se sont établis et ont été les premiers à faire souche dans leur nouvelle patrie. D’autres Levasseur sont venus exercer des fonctions pendant une période donnée au pays et sont retournés dans leur pays d’origine.
Aux 19e et 20e siècles, des personnes portant le nom de Levasseur se sont distinguées et se sont fait remarquer, soit au niveau d’une profession, soit au niveau politique. Des Levasseur ont aussi fait œuvre de pionniers dans les différentes régions du Québec, du Canada et des États-Unis.
Nous voulons faire connaître ces personnes.
Ces informations et les références associées sont extraites des dictionnaires généalogiques « Dictionnaire généalogique des descendants de Laurent Levasseur 1666 – 2008 » et « Dictionnaire généalogique des descendants de Jean et Pierre Levasseur 1645-2008″.
Pierre Levasseur (circa 1627-1694)
et Jeanne de Chanverlange
Pierre Levasseur ainsi que son frère Jean et sa sœur Jeanne sont venus en Nouvelle-France et se sont installés à Québec vers le milieu du 17 e siècle. Ils étaient les enfants de Noël Levasseur et de Geneviève Gaugé. Leur père était maître-menuisier. Pierre a été baptisé vers 1627 dans la paroisse Saint-Leu-et-Saint-Gilles, à Paris.
Le nom de Pierre Levasseur apparaît pour la première fois, le 13 août 1654, dans les registres paroissiaux de Québec, au baptême de Pierre Drolet, le fils de sa sœur Jeanne. Pierre Levasseur est alors parrain de l’enfant.
Tout comme son père, Pierre Levasseur sera maître-menuisier. Il se marie à Jeanne Chaverlange, à Québec, en l’église Notre-Dame, le 23 octobre 1655. Jeanne était la fille d’Antoine Chaverlange et de Marthe Guérin. Elle était originaire de Saint-Ursin, évêché de Bourges.
Une terre sera concédée à Pierre Levasseur, le 4 mars 1657 dans la seigneurie d’Argentenay, à l’île d’Orléans. Cette terre, il la cultivera, mais il n’en obtiendra pas les titres de propriété. Il la vendra 140 livres à Vincent Chrétien, pour les travaux qu’il y a fait, le 26 août 1663.
Le 27 juin 1659, le gouverneur d’Argenson concède à l’ancêtre Pierre, un emplacement à la Haute-Ville de Québec, entre la Grande-Allée et le chemin du Fort. Ce terrain était situé très près du Fort et du Château Saint-Louis. Pierre y fera construire une maison. Il y vivra avec sa famille une très grande partie de sa vie.
Les Pères Jésuites lui concèderont, le 26 août 1663, une terre dans la seigneurie de Sillery. Cette terre, il la gardera jusqu’à sa mort et il la donnera à ses héritiers. François, son fils cadet s’établira sur cette terre.
Pierre Levasseur, tout au long de sa vie, fera divers travaux de menuiserie. Il travaille pour des particuliers ainsi qu’au Fort de Québec. En 1674, il exécute des travaux lors la construction de l’église de Beauport.
Du mariage de Pierre Levasseur et Jeanne de Chaverlange naissent sept enfants, dont quatre filles et trois garçons. Au baptême de son premier enfant en 1656, l’ancêtre se nomme Pierre Levasseur dit Lespérance. Parmi ses fils, seul Pierre aura des descendants. L’ancêtre Pierre Levasseur décède le 12 mars 1694 à l’Hôtel-Dieu de Québec, à l’âge de 67 ans. Son épouse, Jeanne de Chaverlange était décédée antérieurement, probablement entre les années 1679 et 1681.
2 e génération. Pierre Levasseur, fils
Pierre Levasseur, fils, naît le 30 avril 1661, à Québec. Maître-menuisier, il le sera tout comme son père. Il épouse en premières noces Madeleine Chapeau, en l’église NotreDame de Québec le 28 novembre 1686. Le couple aura trois enfants, dont Pierre-Noël (1690-1770) qui deviendra « maître sculpteur ».
En deuxième noces, Pierre Levasseur épouse Anne Mesnage, le 18 mars 1696, en l’église Notre-Dame de Québec. Seize enfants naîtront, dont dix garçons et six filles. Parmi les garçons :
- François Levasseur dit Chaverlange est maître-menuisier à Québec.
- Pierre-Jacques Levasseur dit Carmel est menuisier et marchand. Il s’établira à Boucherville. Ses descendants ont adopté le surnom de Carmel.
- François-Louis-Borgia Levasseur. Il demeura à Québec. Il était voiturier. Ses descendants ont d’abord pris le nom de Levasseur dit Borgia et par la suite, ils ne retiendront que le nom de Borgia.
- François-Ignace Levasseur devient prêtre. Il sera curé à Champlain et à L’Ancienne-Lorette.
- Denis-Joseph, menuisier, s’établit à Trois-Rivières et aura de nombreux descendants dans la région de la Mauricie et des Bois-Francs.
Signature de Pierre Levasseur
Sources consultées :
- LANGLOIS, Michel. Dictionnaire biographique des ancêtres québécois (1608-1700), Sillery, La Maison des ancêtres, 2000, tome 3, p. 287.
- LEVASSEUR, J.-F.-Adrien. Pierre Levasseur dit Lespérance et La première génération en NouvelleFrance, Longueuil, Qc, 1989, 103p.
- MORISSET, Gérard. « Pierre Levasseur, dit L’Espérance », Dictionnaire biographique du Canada, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1967, vol. 1, p. 484-485.
- PRDH. Programme de recherche en démographie historique, [http://www.genealogie.umontreal.ca/fr/].
- SAINTONGE, Jacques. « Jean et Pierre Levasseur », Revue Sainte-Anne, novembre 2000, p. 468-471.
- Michel LANGLOIS, Dictionnaire biographique des ancêtres québécois (1608-1700), Sillery, La Maison des ancêtres québécois, 2000, tome 3, p. 327.
De la rue Guérin Boisseau à Québec : l’arrivée de Jean Levasseur et Marguerite Richard en 1652
Source : https://conversationsancetres.wordpress.com/2019/09/29/70-jean-levasseur-et-marguerite-richard/
L’Association des Levasseur d’Amérique remercie M. Brassard de nous permettre la reproduction de son article qui apporte des nouveaux éléments sur l’histoire du couple Jeanne Levasseur et Christophe Drolet.
(1) Note importante : Dans les retranscriptions d’actes, l’auteur respecte l’orthographe originale, développe les abréviations, et ajoute les accents et la ponctuation pour rendre les textes plus lisibles.
Ce couple arrive à Québec en 1651 ou en 1652. Leur fille Anne est née et baptisée à Québec le 22 juillet 1652. Jean et Marguerite sont peut-être arrivés en Nouvelle France l’année précédente, ou Marguerite aura fait la traversée enceinte au printemps 1652.
Jehan Levasseur et Marguerite Richard passent leur contrat de mariage le 23 avril 1645 devant le notaire parisien Jean Le Semelier. (1) Ce contrat ne permet pas d’en savoir beaucoup plus sur la famille Levasseur, mais il donne des informations qui permettent de mieux connaître la famille de Marguerite.
Jean est dit maître menuisier demeurant rue Guérin Boisseau, paroisse de Saint Nicolas des Champs, et être fils de défunt Noël Levasseur, vivant aussi maître menuisier, et de feue Geneviefve Gaugé. Marguerite est dite fille de Nicolas Richard « quand il vivoit maître lapidaire à Paris et de feue Jeanne Bonnet ». Ses parents étant décédés, c’est son grand-père, François Bonnet, maître patenostrier et marchand verrier, demeurant dans la même rue, qui stipule pour elle.
Les témoins de Jean sont Pierre Levasseur, compagnon menuisier, son frère, Toussaint Asté, maître passementier à Paris, oncle à cause de Marie Gaugé, sa femme, Claude Dufresnoy, maître serrurier à Paris, cousin issu de germain, Louis Dymier, clerc au greffe criminel de la Cour de Parlement, cousin germain à cause de Charlotte Levasseur, sa femme, Pierre Savary, marchand frippier, cousin issu de germain, à cause de Marie Dufresnoy, sa femme, Nicolas Danet, maître charron, son cousin, Noël Roy, meunier, cousin, Jean Hubert, maître tailleur en jais, cousin à cause de Denise Lefébure, sa femme. Jean avantage sa future épouse de la somme de 1000 livres. Il signe en fin de contrat.
Les témoins de Marguerite sont Françoise Gaugé, sa tante, femme de François Bonnet, Denis et François Richard, maîtres passementiers boutonniers à Paris, oncles paternels, Léon Tarisien, maître rubannier à Paris, oncle à cause de Marguerite Richard, sa femme, Guillaume Richard, cousin germain ( un autre acte nous apprend qu’il est fils d’Adrian Richard ), Philippe Dupille, maître passementier boutonnier, Benoist Richard, maître porteur de sel au grenier de Paris, Pierre Rade, maître doreur enlumineur sur cuivre, Nicolas Gobert, praticien, Robert Gobert maître cordonnier, tous cousins, Louis du Hamel, marchand à Paris, cousin. Suivent Girard Grougnes, Jean de Gastines, Nicolas (?) Desnots et Pasquier Godemer, ses amis. Marguerite apporte à la communauté mille livres sur la valeur d’une maison sise rue Guérin Boisseau qui lui appartient par la succession de sa mère, Jeanne Bonnet. Le surplus de la valeur de la maison lui reste en propre et ne fera pas partie de la communauté.
François Bonnet « oncle dudict futur espoux » ( la mère de Jean, Geneviève Gaugé, est la soeur de Françoise Gaugé, femme de François Bonnet ) lui donne la somme de 900 livres sous forme de rente. Si Jean meurt sans enfant, la somme reviendrait à François Bonnet ou à ses autres héritiers. Françoise Gaugé donne « a ladicte future espouse, sa petite fille » la somme de 1200 livres à prendre sur ses biens au jour de son décès, sauf si la future épouse décède sans enfants, auquel cas, les 1200 livres reviendraient aux autres héritiers de Françoise.
Cette profusion de témoins cités dans leur contrat de mariage ne permet malheureusement pas de remonter beaucoup plus loin l’ascendance des époux. Je suis arrivé, en consultant un nombre assez important d’actes, à comprendre les liens de cousinages énoncés dans le contrat, et à bien me représenter les deux familles élargies, mais je n’ai pas pu remonter beaucoup dans l’ascendance de tous ces cousins.
La famille de Marguerite apparaît assez clairement à travers deux actes.
L’inventaire après décès de sa mère, Jeanne Bonnet, d’abord. Il est passé à la requête de Nicolas Richard, son mari, le 17 octobre 1633 devant le notaire Martin Tabouret. (2) On y apprend que Marguerite n’avait qu’un frère, François, mineur comme elle, mais l’inventaire ne donne aucune information sur l’ascendance de Jeanne. François, frère de Marguerite, n’est pas présent lors du contrat de mariage de sa soeur. Était-il décédé, ou avait-il quitté Paris ?
Le contrat de mariage que passe sa tante, également nommée Marguerite, que j’appellerai Marguerite l’aînée, le 24 février 1633, avec Léon Tarisien devant le notaire Denis Camuset, permet de remonter une génération supplémentaire du côté Richard. (3)
C‘est son frère Nicolas qui stipule pour elle. Ses autres témoins sont Anthoine Richard, laboureur à Longvillers Boncourt, en Beauvaisis, son frère, Adrian Richard, bourgeois de Paris, aussi son frère, Denis Richard, maître passementier boutonnier à Paris, François Richard, compagnon du métier de passementier boutonnier, également frères, Jacques Richard, laboureur, neveu (il est le fils d’Anthoine, nommé plus haut). Marguerite la jeune, femme de Jean Levasseur avait donc au moins quatre oncles, Adrian, Anthoine, Denis et François, et une tante, Marguerite.
Le contrat de mariage de Marguerite Richard et Léon Tarisien donne le nom des parents de Marguerite. Il y est question des droits successifs qu’elle tient de la succession de « deffuncte Jehane Dupille, sa mère, au jour de son déceds veufve de feu Pacquin ( ? ) Richard, vivant père d’icelle future espouse ». Pacquin Richard et Jehane Dupille sont les grands-parents de Marguerite Richard, femme de Jean Levasseur.
François Bonnet est présent à la signature de ce contrat de mariage; il est beau-père de Nicolas Richard et doit certainement connaître les autres membres de la famille. Un peu plus étonnant, Noël Levasseur, père de Jean, est aussi présent. Les familles Richard, Bonnet et Levasseur se fréquentent donc déjà en 1633, douze ans avant le mariage de Jean Levasseur et Marguerite Richard.
Denis Richard, oncle de Marguerite la jeune et frère de Marguerite l’aînée, passe un contrat de mariage avec Françoise Régnier le 2 avril 1630 devant le notaire Etienne Gerbault. (4) Il est dit dans le contrat qu’il est veuf de Catherine Lavenue. Le 8 octobre 1618, Martin Ladvenu et Claude Bénédic, sa femme, avaient fait une donation à leur fils, Barthélémy et à leur fille Catherine, femme de Denis Richard.
Le village de Longvillers Boncourt, en Beauvaisis, m’a évidemment mis la puce à l’oreille, et je suis allé consulter les registres de la paroisse sur le site des Archives départementales de l’Oise. La commune a changé de nom après la révolution, et s’appelle désormais Noailles.
Jacques Richard, fils d’Anthoine, (les deux sont présents lors de la signature du contrat de Marguerite l’aînée et de Léon Tarisien), épouse Jehanne Gobert le 23 janvier 1633 à Longvillers Boncourt. (5) Jacques et Jeanne baptisent quelques enfants dans les années qui suivent dans la même paroisse. Après le décès de Jeanne Gobert, le 1er novembre 1640, (6) Jacques Richard épouse Charlotte Thouzin le 20 janvier 1643 à Longvillers Boncourt. (7)
Anthoine Richart, demeurant à Boncourt, est décédé le 27 janvier 1641 et a été inhumé dans le cimetière de Longvillers. (8) Il doit s’agir du frère de Marguerite l’aînée.
Il y a d’autres Richard à Longvillers Boncourt, mais je n’y ai pas trouvé de traces de membres parisiens de la famille Richard. D’autres noms, rencontrés dans les registres de ce village, font cependant penser que la famille y avait des attaches, et peut-être même ses origines. On trouve des Dupille, des Gobert, des Danetz, des Radde, noms qui figurent dans le contrat de mariage de Jean Levasseur et Marguerite Richard. De plus, la grand-mère de Marguerite, femme de Pacquin Richard s’appelait Jehane Dupille.
Dans la paroisse voisine de Ponchon, Philippe Dupille et Françoise Richard se marient le 12 juillet 1644. Leurs parents ne sont pas nommés. (9) Il s’agit peut-être du cousin de Marguerite, présent à la signature de son contrat de mariage avec Jean Levasseur et dans quelques autres actes concernant la famille Richard.
François Bonnet, le grand-père de Marguerite, est intéressant. Il est maître patenostrier en émail et marchand verrier. Le patenôtrier était un artisan qui fabriquait des chapelets. On trouve plusieurs traces de lui dans le Fonds Laborde, et quelques actes dans le Minutier Central des notaires de Paris. C’est lui, on l’a vu, qui stipule pour Marguerite lors de son contrat de mariage en avril 1645.
Sept ans plus tôt, déjà au nom de Marguerite Richard, à titre de tuteur, il avait renoncé le 29 septembre 1638, devant le notaire Martin Prieur, à la succession de Nicolas Richard. (10)
Aujourd’huy est comparu pardevant les notaires gardenotes du roy nostre Sire en son Chastelet de Paris soubz signez, François Bonnet, Maître patenostrier en esmail et marchand verrier à Paris, y demeurant rue Guérin Boisseau, paroisse Sainct Nicolas des Champs, au nom et comme ayeul maternel et tuteur de Margueritte Richard, fille mineure de deffuncts Nicolas Richard, vivant Maître lapidaire à Paris et Jeanne Bonnet, ses père et mère. Lequel, en la présence, du consentement et par l’advis de Adrian Richard, bourgeois de Paris, oncle paternel et subrogé tuteur de ladicte mineure, Denis Richard, Maître passementier boutonnier à Paris, aussy oncle paternel, Léon Tarisien, maître tourneur en bois, oncle paternel à cause de sa femme, Pasquier Godemer, maître passementier boutonnier, amy, Michel Vacquer, maître rentrayeur, amy, et Marin Guérard, compagnon passementier boutonnier aussy amy et voisin, tous demeurant en ceste ville de Paris. A dict et déclaré et par ces présentes déclare qu’il renonce, en la qualité de tuteur de ladicte Margueritte Richard, à la succession dudict deffunct Nicolas Richard son père, attendu qu’elle est plus onnéreuse que profitable à ladicte mineure…
Des cousins de Marguerite se trouveront dans la même situation douze ans plus tard. Les enfants mineurs d’Adrien Richard, praticien frère de Nicolas, et de Suzanne Raveneau, renoncent, de l’avis de leur tuteur Guillaume Richard, leur frère, et de Denis Richard, Philippe Dupille et Léon Tarisien, leurs oncles, à la succession de leurs parents, puisqu’elle serait » plus onnéreuse que profitables » audits mineurs. L’acte est daté du 19 décembre 1645. (11)
François Bonnet, maître patenostrier en émail, et Catherine Hennet ( Humectz ) baptisent deux enfants à Saint Nicolas des Champs, dont le Fonds Laborde a gardé la trace. Jacques, baptisé le 22 juillet 1588 et Dominicque, le 30 janvier 1590.
On apprend aussi dans le Fonds Laborde que le samedy 28 octobre 1624, Catherine Hennet, aagée de cinquante et neuf ans, femme de François Bonnet, maître patenotrier et marchand verrier, prise rue Guérin Boysseau, inhumée à l’églize, avec l’assistance de monsieur le curé et de vingt quatre hommes d’église, y compris les quatre porteurs du corps mort, service complet célébré à son intention, le corps présent. (Saint Nicolas des Champs)
Catherine Hennet, déjà mariée à François Bonnet en 1588, et décédée en 1624 est forcément la mère de Jeanne Bonnet, et la grand mère de Marguerite Richard.
Le 24 octobre 1638, devant les notaires Jacques Roussel et Denis Camuset (dans les minutes duquel on le trouve) avait été passé le contrat de mariage de François Bonnet, maître patenostrier en émail et marchand verrier, et de Françoise Gaugé, veuve de feu Nicolas Richard, vivant marchand lapidaire à Paris. (12) L’acte est passé dans la maison où habite la future épouse, dans sa chambre, en présence de Jeanne Baudellet, sa mère, veuve de feu Gilles Gaugé, Jean Dufresnoy, maître serrurier à Paris, son oncle, Pierre Savary, marchand fripier à Paris, Nicolas Danetz, maître charron, Claude Dufresnoy, maître serrurier, cousins, et Pasquier Godemer, maître passementier boutonnier à Paris, beau-frère.
Le Fonds Laborde nous apprend encore que quatre jours plus tard, Le jeudy 28 octobre 1638, a esté publié le 1er ban entre François Bonnet, maître patenostrier en esmail et marchand verrier, veuf de feüe Catherine Heumet, demeurant rue Guérin Boisseau, d’une part, et Françoise Granger, veufve de feu Nicolas Richard, vivant marchand lapidaire, demeurant en ladicte rue, d’autre part, tous deux de cette paroisse… Espousez le dimanche 14è jour desdicts mois et an* en présence de Claude Bonnet, marchand de vin, aagé de quarante ans, nepveu dudict François Bonnet, demeurant à Rosny, et d’Héleine Bonnet, femme de Robert Gobert, savetier, niepce dudict François Bonnet, demeurant rue Plastrière, et d’Anne Bonnet, femme de Jean de Bréban, maître patenostrier, aussi niepce dudict Bonnet, demeurant rue Saint Denis, et de Jeanne Boudelet, veufve de feu Gilles Gauger, vivant gaignedenier, père et mère de ladicte Françoise Gauger, demeurant Guérin Boisseau, et de Claude du Fresnois, sereurier, cousin maternel de ladicte Gauger, aagé de trente ans, demeurant rue de la Cordonnerie, et de Pierre Savari, maître frippier, aagé de cinquante ans, cousin de ladicte Gauger, demeurant rue de la Fripperie. (Saint Nicolas des Champs)
*Le 14 octobre 1638 n’est pas un dimanche, et les époux ne se seraient certainement pas mariés avant la publication de leur premier ban. Ils se sont mariés le 14 novembre 1638, qui est bien un dimanche.
Toujours dans le Fonds Laborde: Le mardi 19 janvier 1649, François Bonnet, maître patenostrier boutonnier en émail, aagé de quatre vingts dix ans ou environ, a esté pris rue Guérin Boisseau, porté et inhumé dans l’église, service complet avec les chants à son intention, le corps présent, avec l’assistance de monsieur le curé et de vingt quatre presbtres. (Saint Nicolas des Champs)
Françoise Gaugé est qualifiée de tante de Marguerite Richard dans son contrat de mariage avec Jean Levasseur. Je ne suis pas arrivé à trouver de quelle façon elle pouvait être sa tante. Les liens entre Jean Levasseur, Marguerite Richard, François Bonnet et Françoise Gauger sont étonnants. Je n’ai pas croisé souvent une telle superposition de liens. François Bonnet est oncle par alliance de Jean Levasseur, puisque sa seconde épouse est la sœur de Geneviève Gaugé, mère de Jean. Il est également le grand-père de Marguerite Richard. Françoise Gaugé est tante maternelle de Jean Levasseur, mais fut également la belle-mère de Marguerite Richard, ayant épousé Nicolas Richard, et elle fut encore la belle-grand-mère de Marguerite par son mariage avec François Bonnet.
Françoise en était probablement à son troisième mariage, ayant épousé en première noces Pierre Godemer, maître passementier boutonnier. Les deux époux se font une donation mutuelle le 3 janvier 1628 devant Pourcel et Pourcel, notaires à Paris. (13) Le nom de Françoise est, dans cet acte, d’abord écrit Goger, puis Gauger. Ce premier mariage expliquerait la présence de Pasquier Godemer, cité comme beau-frère de Françoise dans son contrat de mariage avec François Bonnet.
Dans son testament, passé le 11 juin 1658 devant Etienne Thomas, notaire à Paris (14), outre les dispositions qu’elle prend au plan religieux, Françoise Gaugé fait les donations suivantes:
- elle lègue trente livres à l’Hôpital général
- elle lègue trente livres à l’oeuvre et fabrique de Saint Nicolas des Champs, sa paroisse
- elle donne et lègue à Nicolas de Gastines, « son compère et son amy » (le mot compère s’emploie souvent pour désigner le parrain), la somme de cent livres.
La suite concerne ses neveux et nièces.
Et quand au surplus et residu de tous et chacun ses biens, tant meubles qu’immeubles, de quelque nature qu’ils soient, ladicte testatrice les donne, lègue et laisse, scavoir moictyé à Françoise Hatté, sa niepce, ou sy elle deceddait avant ladicte testatrice à Margueritte le Roy, sa fille, et l’autre moictyé à Pierre et Jeanne le Vasseur, ses nepveu et niepce esgallement ou à leurs enffants s’ils estaient déceddés avant ladicte testatrice, faisant ladicte Françoise Hatté, sa niepce, sa légataire universelle pour moictyé en sesdicts biens, et lesdicts Pierre et Jeanne le Vasseur pour l’autre moictyé esgallement. Daultant qu’à l’esgard de Jean le Vasseur, son nepveu à cause de Margueritte Richard, sa femme, il a esté advantagé par ladicte testatrice suffisamment par son contrat de mariage au moien de quoy, icelle testatrice veult et déclare qu’iceulx Jean le Vasseur et sa femme ne puissent rien prétendre ny avoir aucune chose en sadicte succession.
Françoise Gaugé, on l’a vu plus haut, avait donné à Marguerite Richard, en faveur de son mariage avec Jean Levasseur, 1200 livres à prendre sur ses biens au jour de son décès.
Un codicille est ajouté au testament le 16 octobre 1666. Françoise est au lit, malade de corps mais saine d’esprit. Elle révoque la donation de trente livres à l’Hôpital général, et déclare que ces trente livres iront aux enfants de Crestophle de Rollet et de Jeanne Levasseur, sa femme.
Le 8 janvier 1659, Jean Levasseur est à Paris. Son épouse, Marguerite Richard lui a donné procuration pour aller régler ses affaires à Paris, vendre, louer ou bailler à rente les biens immobiliers qu’elle tient de sa mère et de son grand-père. Jean se présente avec Françoise Gaugé devant le notaire Etienne Thomas pour régler le partage des biens de François Bonnet, dont Marguerite est dite seule et unique héritière. Jean Levasseur et sa tante s’entendent sur les comptes, Françoise gardant les biens qui lui sont dus aux termes de son contrat de mariage et de la donation entre époux qu’elle avait passé avec son défunt mari. et de divers actes qui sont cités dans ce partage. Elle conservera en pleine propriété une maison rue Guérin Boisseau, et Marguerite recevra une autre maison, située dans la même rue.
L’inventaire après décès de Françoise Gaugé, fait devant Etienne Thomas, notaire, le 4 novembre 1666 (15), confirme les éléments contenus dans son testament. Il contient des copies du contrat demariagedeJean Levasseur et Marguerite Richard, et de celui de Christophe Drollet et Jeanne Levasseur, puisque Françoise avait fait des donations aux deux couples lors le la signature de ces contrats. L’inventaire ne donne malheureusement pas d’informations sur les deux premiers mariages de Françoise Gaugé, avec Pierre Godemer puis Nicolas Richard.
En regardant le contrat de mariage de Jean Levasseur avec Marguerite Richard, et celui de François Bonnet avec Françoise Gaugé, on croise deux personnes intéressantes.
Marie et Claude Dufresnoy, cités dans les deux contrats, sont dits cousins issus de germains de Jean Levasseur, et cousins maternels de Françoise Gaugé. La mère de Marie et Claude Dufresnoy, dont le père, Jean, est également cité comme oncle de Françoise Gaugé, est forcément une soeur de Jeanne Baudelet.
Pour que les Dufresnoy soient cousins issus de germain de Jean Levasseur, il faut que leur père ou leur mère soit cousin germain de Noël Levasseur ou de Geneviève Gaugé.
Le contrat de mariage de Claude du Fresnoy avec Mathurine Berrié donne la réponse. Il est passé devant Jean le Semelier, notaire à Paris, le 2 février 1651. Les minutes de le Semelier pour cette année-là sont perdues, mais le contrat apparaît dans les insinuations du Châtelet de Paris. (16) Claude y est dit fils de défunt Jean du Fresnoy, maître serrurier, et de Mathurine Baudelet, jadis sa femme.
Pour terminer, je joins le bas de la page où sont les signatures des témoins au contrat de mariage de Jean Levasseur et Marguerite Richard.
-
- La marque de François Bonnet, grand-père de Marguerite. Il ne sait pas signer.
- Jean Levasseur
- Louis Dymier, cousin germain de Jean à cause de Charlotte Levasseur
- Pierre le Vasseur, frère de Jean
- Girard Grougnes, ami de Marguerite
- Toussainct Asté, oncle de Jean
- Claude du Fraisnoy, cousin issu de germain de Jean
- Nicolas Danets, cousin de Jean
- Jehan Hubert, cousin de Jean à cause de Denise Lefébure, sa femme
- Louys du Hamel, cousin de Marguerite
- Jehan de Gastines, ami de Marguerite
- Nicolas Desnots, ami de Marguerite
- Denis Richard, oncle de Marguerite
- François Richard, oncle de Marguerite
- Philippe Dupille, cousin de Marguerite
- Benoist Richard, cousin de Marguerite
- Nicolas ou Robert Gobert, cousin de Marguerite
- Pierre Rade, cousin de Marguerite
- Nicolas ou Robert Gobert, cousin de Marguerite
- Le Cat, notaire
- Le Semelier, notaire
Notes:
Dans mes articles, mes transcriptions reprennent l’orthographe originale, mais je développe les abréviations, et j’ajoute les accents et la ponctuation pour rendre les textes plus lisibles.
(1) Archives Nationales de Paris, minutes du notaire Jean le Semelier, MC/ET/LIX/103
(2) AN de Paris, minutes du notaire Martin Tabouret, MC/ET/IX/369
(3) AN de Paris, minutes du notaire Denis Camuset, MC/ET/XXXV/132
(4) AN de Paris, minutes du notaire Etienne Gerbault, MC/ET/II/132
(5) Archives départementales de l’Oise, 3E462/1, BMS Noailles 1605/1738, vue 71/334, page de droite
(6) AD de l’Oise, 3E462/1, BMS Noailles 1605/1738, vue 87/334, page de droite
(7) AD de l’Oise, 3E462/1, BMS Noailles 1605/1738, vue 92/334, page de droite
(8) AD de l’Oise, 3E462/1, BMS Noailles 1605/1738, vue 89/334
(9) AD de l’Oise, 3E504/1, BMS Ponchon 1614/1696, vue 139/291 page de droite
(10) AN de Paris, minutes du notaire Martin Prieur, MC/ET/LII/13
(11) AN de Paris, Registre des Tutelles, Y//3916, consulté sur le site Familles Parisiennes
(12) AN de Paris, minutes du notaire Denis Camuset, MC/ET/XXXV/154
(13) AN de Paris, Insinuations du Châtelet de Paris, Y//168
(14) AN de Paris, minutes du notaire Etienne Thomas, MC/ET/LVII/74
(15) (14) AN de Paris, minutes du notaire Etienne Thomas, MC/ET/LVII/89
(16) Insinuations du Châtelet de Paris, Y//189
Laurent Levasseur (circa 1647-1726)
et Marie Marchand
Au XVII siècle, les Normands ont été relativement nombreux à voguer vers la Nouvelle- France. Parmi eux, on retrouve Laurent Levasseur, l’ancêtre du plus grand nombre de Levasseur en Amérique. Il est le fils de Jean Levasseur et de Marguerite Maheu. Il est né vers 1648, probablement à Bois-Guillaume en Normandie.
Arrivée
Laurent Levasseur est mentionné pour la première fois dans la colonie lors du recensement de 1666. Il se dit âgé de dix-huit ans. Il est un « engagé » chez Guillemette Hébert, veuve de Guillaume Couillard et fille du premier colon canadien Louis Hébert. Laurent s’initie probablement aux travaux de la terre ainsi qu’à la pêche à l’anguille. Au recensement de 1667, nous ne trouvons plus de trace de Laurent Levasseur. Son engagement de « 36 mois » étant probablement terminé, il était libre pour aller explorer sa nouvelle patrie.
Laurent pourrait donc avoir fait partie des engagés arrivés au pays en septembre 1663. Il aurait eu environ quinze ans. L’année suivante, soit en 1664, le Conseil souverain se plaignit au roi, que « la plupart des recrues de 1663 étaient des jeunes gens, clercs, écoliers dont la majeure partie n’avait jamais travaillé ». Il est fort possible que Laurent fut parmi ce groupe de jeunes. Entre 1667 et 1669, Laurent n’a laissé aucune trace.
Établissement
« Le 5 avril 1669, le roi signe un édit où il prévoit une amende pour ceux qui ne sentent pas assez tôt l’attrait du mariage. »
Laurent a compris le message. Il est temps pour lui d’acquérir une terre dans son nouveau pays et de se marier. Après mûre réflexion, il décide de s’établir à la côte de Lauzon, située sur le bord du fleuve Saint-Laurent presqu’en face de Québec. Le 22 septembre 1669, il loue une terre de trois arpents de large par quarante arpents de profondeur avec « pêche » pour trois ans de Henri Brau , sieur de Pominville.
Mariage
Laurent peut maintenant penser au mariage. Il semble avoir trouvé la perle rare. Le 19 novembre 1669, il contracte mariage, devant le notaire Romain Becquet, avec Marie Marchand, qui est la fille de Louis Marchand et de Françoise Morineau, de Saint-Martin de l’Île de Ré en Normandie. Il l’épousera à Québec, en l’église Notre-Dame, le 30 avril 1670. Le couple aura quatorze enfants. Parmi ceux-ci, trois garçons et une fille fonderont une famille; deux filles se retireront du monde pour devenir sœurs converses chez les Ursulines; cinq enfants mourront en bas âge et une fille handicapée sera placée à l’Hôpital général de Québec, après le décès de sa mère. Laurent assurera une pension pour ses filles religieuses ainsi que pour sa fille qui vit à l’Hôpital général.
En 1709, selon la carte de Gédéon de Catalogne, Laurent possède trois terres qui longent le fleuve. Au cours de sa vie, Laurent sera le propriétaire de cinq terres sur la côte de Lauzon en plus de celle qu’il avait louée pour trois ans en 1669. Il fut vraisemblement un homme bien entreprenant. Selon Adrien Levasseur, « Les terres qu’il exploitait à une certaine époque avaient une superficie de quatorze arpents de front sur quarante arpents de profondeur, soit beaucoup plus que ce que la plupart des colons possédaient. » En plus de cultiver la terre, Laurent faisait la pêche à l’anguille ainsi que la chasse comme en témoignent quelques documents notariés. Selon le jésuite Charlevoix, « la pêche et la chasse fournissent abondamment de quoi vivre à ceux, qui veulent s’en donner la peine. On pêche dans le fleuve Saint- Laurent une quantité prodigieuse de grosses anguilles ».
Au terme d‘une vie bien remplie, Laurent décède à Québec le 26 décembre 1726 et est inhumé le lendemain à l’église Notre-Dame de Québec. Son épouse, Marie, l’avait précédé dix ans plus tôt. Les descendants de Laurent se retrouvent maintenant aux quatre coins du Québec, mais surtout dans la région du Bas Saint-Laurent. Plusieurs familles de cet ancêtre ont aussi essaimé aux États-Unis et dans les autres provinces du Canada, plus particulièrement au Nouveau-Brunswick et en Ontario.
Enfin, contrairement à plusieurs de ses compatriotes, Laurent Levasseur pouvait signer, chose assez rare à l’époque.
Signature de Laurent Levasseur
Source : Joceline Levasseur
- Les registres d’état civil sont manquants entre 1642 et 1667 à Bois-Guillaume.
- Au début de la colonie, les armateurs privés, transportant les fourrures en France, s’étaient engagés à transporter un nombre d’immigrants en Nouvelle France. Ils se faisaient rembourser les frais de voyage par les cultivateurs déjà établis au pays qui avaient besoin d’aide. L’agriculteur était à son tour dédommagé par les trois ans de service de l’engagé.
- Jacques LACOURSIÈRE, Histoire populaire du Québec des origines à 1791, Québec, Septentrion, 1995, p. 127
- Bail à ferme d’Henri Breau de Pomainville à Laurent Levasseur, greffe Pierre Duquet de Lachenaye, 22 septembre 1669. dans Parchemin
- Selon Adrien Levasseur, cette terre ne serait pas la terre occupée par les descendants de Laurent Levasseur jusqu’en 1925 comme l’affirmait J. Edmond Roy.
- J.-F. Adrien LEVASSEUR, Laurent Levasseur. Origine et Histoire et la première génération en Nouvelle-France
- Ibid., p. 30 8
- Michel LANGLOIS, Dictionnaire biographique des ancêtres québécois (1608-1700), Sillery, La Maison des ancêtres québécois, 2000, tome 3, p. 327.
Jean Levasseur dit Lavigne (1922-1686)
et Marguerite Richard
Il contracte mariage à Paris devant les notaires Le Cat et Le Semelier, le lundi 23 avril 1645, avec Marguerite Richard qui est la fille du maître lapidaire Nicolas Richard et de Jeanne Bonnet(2) . De leur union naissent onze enfants.
L’esprit d’aventure et la recherche d’un mieux-être sont des facteurs qui amènent probablement le jeune couple et leur premier enfant Louis à traverser l’Atlantique afin de s’établir en Nouvelle-France, plus particulièrement à Québec. Ils arrivèrent aux environs de 1651.
Jean Levasseur est mentionné pour la première fois dans la colonie aux registres d’état civil de la paroisse de Notre-Dame de Québec, le 22 juillet 1652, lors du baptême de sa fille Anne. Le parrain et la marraine furent le gouverneur de la Nouvelle-France, Jean de Lauzon, et son épouse, Anne Després.(3)
Marguerite Richard, son épouse, avait quelques biens à Paris. Le 18 août 1658, elle donne une procuration à son mari qui va en France. Ce document notarié permettra à Marguerite de toucher une part de la succession des biens de son défunt père. Celui-ci avait une maison, rue Guérin Boisseau à Saint-Nicolas-des-Champs de Paris. On la reconnaissait par l’enseigne représentant l’image de Sainte-Anne et de Sainte-Barbe. Après avoir passé l’hiver en France, Jean est de retour au pays l’année suivante. Le 18 octobre 1659, sa femme Marguerite Richard ratifie les transactions qu’il a réalisées avec Françoise Gogé, veuve de Nicolas Richard. À l’automne 1660, Jean retourne en France avec une procuration de sa femme, semblable à la première, pour vendre encore deux autres maisons qui font partie de la succession de son beau-père.(4)
Pour un maître-menuisier, le travail ne manquait pas dans la jeune colonie. Les talents de Jean furent mis à contribution pour répondre aux besoins de la population qui grandissait de jour en jour. « Le 13 août 1654, il passe un marché avec la Fabrique de Notre-Dame de Québec. Les marguilliers lui confient l’entretien de l’église, au salaire de 30 sols par jour »(5) . Aussi, il effectua de nombreuses transactions immobilières comme en font foi les multiples actes notariés que nous pouvons consulter aux Archives nationales de Québec. Étant très près du gouvernement de la Nouvelle-France, cela lui assura aussi plusieurs contrats intéressants en menuiserie. Enfin, Jean Levasseur estl’un des fondateurs de la Confrérie de Sainte-Anne, un regroupement de menuisiers qui a pour la sainte patronne une dévotion particulière.
En plus de son travail de menuiserie, Jean fut huissier au Conseil Souverain de la Nouvelle-France, charge qui lui fut attribuée le 22 avril 1664. Plus tard, soit en 1681, il deviendra huissier de la Prévôté de Québec.(6)
Selon Sergine Desjardins, dans son roman historique Marie Major, Jean Levasseur dit Lavigne et sa femme Marguerite Richard accueillirent plusieurs Filles du roi dans leur grande maison de la rue Saint-Louis entre 1665 et 1673. Plusieurs d’entre elles, dont Marie Major, ont passé un contrat de mariage notarié dans leur demeure.(7)
Après une vie bien active dans la jeune colonie, Jean Levasseur dit Lavigne décède à Québec le 31 août 1686 et y est inhumé le lendemain.
Son épouse, Marguerite Richard, décédera beaucoup plus tard, soit le 23 avril 1708 à L’Ancienne-Lorette à l’âge de 78 ans.
La descendance masculine de Jean Levasseur sera assurée par son fils Noël qui est le père du maître sculpteur, Noël Levasseur. Aussi, il semble que son fils Charles pourrait avoir pris part aux voyages d’exploration de Robert Cavelier de La Salle et de Pierre Le Moyne d’Iberville. Il aurait eu le titre de major dans l’armée (8) . La descendance en ligne directe de Jean ne compte aujourd’hui que quelques familles. La descendance par ses filles est beaucoup plus importante.
Jean Levasseur était le frère de Pierre Levasseur dit Lespérance, époux de Jeanne Chaverlange et aussi le frère de Jeanne Levasseur, épouse de Christophe Drolet.
- PRDH. Programme de recherche en démographie historique.
- La Fédération québécoise des sociétés de généalogie et la Fédération française de généalogie, Fichier Origine, [www.fichierorigine.com].
- PRDH. Programme de recherche en démographie historique.
- Michel LANGLOIS, Dictionnaire biographique des ancêtres québécois (1608-1700), Sillery, La Maison des ancêtres québécois, 2000, tome 3, p. 283.
- Ibid, p. 283.
- J.-F.-Adrien LEVASSEUR, Pierre Levasseur dit Lespérance et la première génération en Nouvelle France, Longueuil, J.-A. Levasseur, 1989, p. 6.
- Sergine DESJARDINS, Marie Major, Laval, Guy Saint-Jean, 2006, p. 460.
- Archange GODBOUT, Fonds Godbout (4M00-4610), BAnQ-Q.
- Michel LANGLOIS, Dictionnaire biographique des ancêtres québécois (1608-1700), Sillery, La Maison des ancêtres québécois, 2000, tome 3, p. 327
Des Levasseur en Amérique avant 1800
- Jean Levasseur dit Lavigne (vers 1622-1686)
- Jean est originaire de la paroisse Saint-Leu-et-Saint-Gilles de Paris. Il se marie avec Marguerite Richard, selon le contrat de mariage passé, le 23 avril 1645, à Paris devant les notaires Le Cat et Le Semelier. Le couple arrive en Nouvelle-France avec leur fils Louis, vers 1651. Jean est maître-menuisier et devient le premier huissier au Conseil Souverain. La descendance de Jean est estimée à environ 340 personnes.
- Pierre Levasseur dit Lespérance (vers 1627-1694)
- Pierre, tout comme son frère Jean ci-dessus, est originaire de la paroisse Saint-Leu-etSaint-Gilles de Paris. Il épouse Jeanne Chaverlange, le 25 octobre 1655 à Québec. Sa descendance est estimée à 6 359 personnes. Pierre est aussi l’ancêtre des Borgia ainsi que d’une souche de descendants portant le patronyme de Carmel.
- Jeanne Levasseur
- Jeanne est la sœur de Jean et Pierre Levasseur qui sont venus en Nouvelle-France. Elle arrive au pays, mariée à Christophe Drolet. En 1654, leur fils Pierre sera baptisé à Québec. Jeanne et Christophe retourneront en France en 1672. Leur fils Pierre restera au pays et sera à l’origine de tous les Drolet d’Amérique.
- Laurent Levasseur (vers 1648-1726)
- Laurent est originaire de la paroisse Sainte-Trinité de Bois-Guillaume, archevêché de Rouen en Normandie. Son nom apparaît pour la première fois au recensement de 1666. Il est un engagé de Guillemette Hébert, veuve de Guillaume Couillard. Laurent se marie avec Marie Marchand, le 30 avril 1670 à Québec. Sa descendance est estimée à 8 245 personnes.
- Louis Levasseur sieur de Lespérance (vers 1636-1690)
- Louis est originaire de Saint-Jacques de Paris. Il épouse Marguerite Bélanger, le 13 décembre 1666 à Château-Richer, Montmorency, QC. Il décède à Québec en 1690. Sa descendance est estimée à 13 personnes.
- Henri Lamarre dit Belisle (vers 1669-1740)
- Ancêtre des Levasseur dit Belisle Henri est originaire de Saint-Michel-la-Palud, Angers, Maine-et-Loire, en France. Il est le fils d’Antoine Lamarre et de Marguerite Levasseur. Il est maître-chirurgien. Il se marie une première fois sous les noms de Henri Lamarre dit Belisle, avec Catherine Demosny, le 26 juin 1690 à Québec. Par la suite, il adopte le nom de Henri Belisle. En deuxièmes noces, Henri épouse Françoise Perinne Dandonneau, le 26 novembre 1705, à Champlain. En troisièmes noces, il prend Jeanne Archambault comme épouse, le 25 août 1712, à Pointe-aux-Trembles, Montréal. Des descendants de ce troisième mariage ont adopté les noms de famille Levasseur dit Belisle. Henri est l’ancêtre des Levasseur dit Belisle.
- Charles-René Vassor dit Lafraicheur (vers 1724-1781)
- Charles-René est originaire de la paroisse Saint-André-des-Arts de Paris. Il se marie, une première fois avec Geneviève Grosnier le 13 janvier 1750, à Québec. Dans son acte de mariage, on dit qu’il est soldat de la Compagnie de Saint-Vincent. Il épouse en deuxièmes noces Josephte Bouteiller le 4 avril 1758 à Rivière-des-Prairies. En troisièmes noces, il se marie avec Amable Poudret dit Lavigne le 12 octobre 1761 à Rivière-des-Prairies. Après 1772, lors du baptême de ses enfants, il adopte le nom de Levasseur. Sa descendance est estimée à 201 personnes.
- Jacques Levasseur de Neré (vers 1662-vers 1723)
- Jacques est originaire de Paris. Il se marie avec Marie Françoise Achille Chaveneau, vers 1694, en France. Il arrive en Nouvelle-France en 1694, comme ingénieur militaire du roi. Il retourne en France. Sa descendance est estimée à 14 personnes.
- Pierre Levasseur dit Saint-Pierre (vers 1719-1774)
- Pierre est originaire de Notre-Dame de Peronne, Picardie. Il épouse Marie-Louise Durbois dit Léonard, le 31 août 1750 au Fort Frédéric, Beauharnois. Il retourne en France. Sa descendance est estimée à 10 personnes.
- Jean LeVasseur (vers 1683- avant 03-11-1734)
- Jean est originaire de Saint-Jacques, Dieppe, en Normandie. En Nouvelle-France, il était soldat de la Marine, compagnie de Dumesnil. Il se marie avec Barbe Chevalier, le 14 mars 1713 à Montréal. Une fille assure sa descendance.
- René-Nicolas Levasseur (vers 1707–1784)
- René-Nicolas est né à Rochefort. Il est chef de la construction navale royale et inspecteur des bois et forêts au Canada. En 1738, le roi l’envoie à Québec pour établir des chantiers de construction navale. Il arrive avec son épouse Angéline Juste ainsi que ses filles Marie-Françoise-Renée et Marie-Anne. La première se marie avec Barthélemy Martin le 31 août 1752, à Québec et Marie-Anne épouse Alexandre Robert le 21 septembre 1760, à l’église Notre-Dame de Montréal. René-Nicolas et sa famille sont retournés en France en 1760.
- Michel Levasseur
- Michel est orfèvre et il réside en Nouvelle-France de 1699 à 1712 environ. Il était l’époux de Madeleine Villers. Ce couple fera baptiser sept enfants à Québec entre 1700 et 1710. Trois de leurs enfants décèdent en bas âge. La dernière est décédée le 8 février 1712 à L’Ancienne-Lorette. Michel a enseigné l’orfèvrerie aux apprentis Pierre Gauvreau et Jacques Pagé dit Carcy. On peut penser qu’il est retourné en France après 1712.
- François Vavasseur François est né vers 1702
- Il est originaire d’Orléans, en France. Il épouse Marguerite Chaille, à Québec en 1732. Quatre enfants seront baptisés à Québec.
- Jeanne Levasseur (1631-1673)
- Jeanne est une Fille du Roi, originaire de Rouen (St-Éloi). Elle est la fille de Nicolas Levasseur et de Catherine Leforestier. Elle épouse Barthélemy Tesson à Québec, le 24 octobre 1667. Elle décède en France le 29 mai 1673.
- Sieur Le Vasseur
- En 1542, il y a un Sieur Le Vasseur qui se noie lors d’un voyage d’exploration sur la rivière Saguenay. Il était l’un des passagers du voyage du Sieur Jean-François de La Rocque de Roberval en Nouvelle-France.
- Jacques Levasseur
- Jacques est originaire de l’Évêché de Lisieux, en France. Au recensement de 1666, il est un domestique engagé chez Marie Bourdon, veuve de Jean Gloria. Il est alors âgé de 33 ans.
- Jean Levasseur
- Au recensement de 1666, Jean, âgé de 20 ans, est un domestique engagé chez Jacques Bilodeau, habitant de l’Île d’Orléans.
- Jean Levasseur
- Au recensement de 1667, Jean, âgé de 28 ans, est un domestique engagé chez Jean Primont, habitant de l’Île d’Orléans.
- Guillaume Levasseur
- En 1601, Guillaume Levasseur, cartographe européen influent, a dressé la carte de l’océan Atlantique. Cette carte présente entre autres, la géographie de l’Est du Canada. Le golfe et le fleuve Saint-Laurent y sont dessinés. Les noms de QUEBECQ, 3 RIVIERES, HOCHELAGA, TADOUSSAC y sont inscrits. Guillaume Levasseur était originaire de Dieppe en Normandie. À l’époque, les cartographes travaillaient avec les explorateurs et les pêcheurs qui exploraient les côtes. Ceux-ci leur transmettaient des renseignements sur leurs voyages. Les cartographes dressaient alors les cartes. Guillaume Levasseur est-il venu en Nouvelle-France? Nous l’ignorons.
Note : L’estimation du nombre de descendants a été faite à partir des données recueillies dans la banque de données de l’Association des Levasseur d’Amérique inc, en date du 26 mars 2008.
D’un héritage à l’autre : les traces parisiennes de Jeanne Levasseur et de ses descendants (1)
Source : https://conversationsancetres.wordpress.com/2019/10/06/71-jeanne-levasseur-et-christophe-drolet/
Auteur : M. Gilles Brassard.
L’Association des Levasseur d’Amérique remercie M. Brassard de nous permettre la reproduction de son article qui apporte des nouveaux éléments sur l’histoire du couple Jeanne Levasseur et Christophe Drolet.
(1) Note importante : Dans les retranscriptions d’actes, l’auteur respecte l’orthographe originale, développe les abréviations, et ajoute les accents et la ponctuation pour rendre les textes plus lisibles.
Jeanne Levasseur et son mari Christophe Drollet, venus à Québec probablement en même temps que les frères de Jeanne, Jean Levasseur dit Lavigne et Pierre Levasseur dit Lespérance, ne sont pas restés en Nouvelle-France. Ils ont fait deux séjour à Québec, et fait deux fois la traversée. On les croise dans les registres de Notre Dame de Québec en 1654, on l’a vu au début du premier article consacré à la famille ( 69. Pierre, Jean et Jeanne Levasseur ). Ils sont repassés en France à une date inconnue.
On retrouve Christophle Drollet, marchand, qui comparaît le 11 juillet 1664 à Paris pour donner son conseil et avis sur une affaire qui concerne les enfants mineurs de défunts Pierre Savary et Marie Du Fresnoy. (2) Pierre Savary était présent à titre de cousin issu de germain de l’époux lors de la signature du contrat de mariage du frère de Jeanne, Jean Levasseur et de Marguerite Richard. La femme de Pierre Savary, Marie du Fresnoy, est fille de Jean Du Fresnoy et de Mathurine Baudelet. Mathurine est la soeur de Jeanne Baudelet, grand-mère maternelle de Jean, Pierre et Jeanne Levasseur
Le 14 juin 1665, Christophe Drollet est toujours à Paris. Il est présent lors de la signature du contrat de mariage entre Anthoine Tharizien, fils de Léon et de Marguerite Richard l’aînée, avec Marguerite Françoise Le Roy, veuve de Claude Besnard, et fille de Noël Le Roy et de Françoise Hatte. (3) Dans cet acte, passé devant le notaire Nicolas Périer, Christophe est dit maître passementier boutonnier à Paris. Le futur époux, Anthoine Tharizien, est cousin germain de Marguerite Richard, femme de Jean Levasseur, et la mère de la future épouse, Françoise Hatte, est cousine germaine des Levasseur. Christophe Drollet ( le notaire écrit De Rollet ) est présent à titre de cousin de la future épouse « à cause de Jeanne Levasseur sa femme ». Il signe à la dernière page du contrat avec les autres témoins sachant écrire. Il signe d’une écriture qui n’est pas très assurée « Christhofle Drolet ».
Christophe est présent et signe lors de l’inventaire après décès de Françoise Gaugé, tante de son épouse et veuve de François Bonnet, fait « pardevant » Dupuys et Thomas, notaires à Paris, le 4 novembre 1666. (4) Cet inventaire confirme ce qui était inscrit dans le testament de Françoise (voir l’article 70. Jean Levasseur et Marguerite Richard ): elle lègue à ses neveu et nièces la totalité des biens qui lui restent, séparés en deux moitiés, une pour Françoise Hatté, et l’autre pour Pierre et Jeanne Levasseur. Christophe est présent à titre d’époux de Jeanne. Pierre est représenté par « Maître Pierre Imbert, conseiller du Roy et substitut de Monsieur le procureur du Roy au Chastelet de Paris, pris et appelé pour l’absence de Pierre Le Vasseur, de présent « estant à Kebecq », en la Nouvelle France ».
Signature « Christhofle Drolet » lors de l’inventaire après décès de Françoise Gaugé.
Un des actes inventoriés dans l’inventaire après décès de Françoise Gaugé est le contrat de mariage de Christophle Drollet et de Jeanne le Vasseur, passé devant François Blanche et Jacques Rallu le 22 juillet 1650. J’ai parcouru les minutes de Blanche pour l’année 1650, mais le contrat de mariage n’y est pas. Rallu est notaire de 1648 à 1689 dans l’Etude LXIII, mais ses minutes sont perdues. J’ai bien peur que plusieurs des actes concernant Christophe et Jeanne aient été passé devant ce notaire qui avait rédigé leur contrat de mariage.
On peut se demander si l’héritage de Françoise Gaugé n’a pas donné l’occasion à Christophe Drolet et Jeanne Levasseur, tout en se chargeant d’apporter leur part à Pierre Levasseur et à sa femme, de retenter leur chance en Nouvelle France.
Christophe est présent à Québec le 15 octobre 1668 lors de la signature d’un acte devant le notaire Jean Lecomte; il y est question d’un bail à ferme entre Jean Levasseur, d’une part, et Charles Palantin et Christophe Drolet, d’autre part. Je n’ai pas pu consulter cet acte.
À Québec, le 7 décembre 1669, Jacqueline, fille de Christophe Drolet et Jeanne Levasseur, âgée de 5 ans, est inhumée. Elle était certainement née en France, puisque Christophe Drollet était présent à Paris en 1664.
Le couple repasse ensuite définitivement en France, laissant leur fils Pierre Drollet à Québec, où il fera souche en épousant Catherine Routier en 1688.
On apprend le nom des parents de Christophe Drolet grâce à l’inventaire après décès de sa mère. L’inventaire des biens de Marie Godemer, conservé dans les minutes du notaire Martin Prieur, et daté du 15 mai 1638 (5), est fait à la requête de « Louis Godemer, maître passementier boutonnier à Paris, y demeurant rue des Gravilliers, paroisse Saint Nicolas des Champs, au nom et comme tuteur de Christophle, agé de treize ans, Anthoine, aagé de seize ans et Françoise Drollet, aagée de sept ans ou environ, enfants mineurs de deffunct Christophle Droslet, vivant aussy maître passementier boutonnier à Paris et de Marie Godemer, jadis sa femme, leur père et mère, comme « aussy à la requeste » de Pierre Soret, compagnon taillendier à Paris, y demeurant rue Guérin Boisseau, paroisse Saint Nicolas des Champs, tant en son nom, à cause de la communauté de biens qu’il a eue avec ladicte deffuncte Marie Godemer, jadis sa femme en secondes nopces, que comme tuteur de Marie Soret, agée de deux ans et demy ou environ, fille mineure demeurant de « luy et de ladicte deffuncte » Marie Godemer et en la présence de Michel Vacquer ( Vacquet ), maître rentrayeur à Paris, subrogé tuteur… » L’inventaire ne contient malheureusement pas de « titres et papiers » qui permettent habituellement d’en savoir plus sur le couple et leurs parents. Marie Godemer s’étant remariée après le décès de son premier mari, et laissant de ce second mariage une fille de deux ans et demi, Christophe Drollet père a du mourir avant le début de l’année 1635. Je n’en ai pas trouvé trace, ni non plus du frère, de la soeur et de la demi-soeur de Christophe fils. On peut noter que Michel Vacquer était déjà présent dans l’acte de renonciation par François Bonnet, au nom de sa petite fille Marguerite Richard, à la succession de Nicolas Richard. (voir l’article no 70).
Outre les actes dont j’ai parlé plus haut, un autre inventaire après décès est plus qu’intéressant. Je n’en ai pas la preuve formelle, mais quelques éléments qu’il contient me font penser qu’il s’agit très probablement de l’inventaire réalisé après le décès d’un des fils de Christophe Drollet et de Jeanne Levasseur.
Le 31 mars 1693, devant le notaire parisien Antoine Hurel, est réalisé l’inventaire après décès de Noël Droley, en son vivant maître passementier boutonnier, demeurant rue Guérin Boisseau, paroisse de Saint Nicolas des Champs, fait à la requête de Jeanne Feusché, sa veuve, en son nom et comme tutrice de Marguerite Droley, leur fille mineure. (6) Le subrogé tuteur de Marguerite est Anthoine Collot, maître charpentier. La tutrice et le subrogé tuteur attendent le résultats de l’inventaire pour savoir s’ils vont, au nom de l’enfant, accepter la succession où y renoncer, ne sachant pas encore si elle sera profitable ou onéreuse. L’inventaire est effectivement très court, ne contient pas de papiers qui auraient pu nous dire quand le couple s’était marié.
Le même jour, Jeanne Feusché signe un contrat de mariage avec Jean-François d’Hautancourt, maître charpentier. Jeanne est dite veuve de Noël Drolay, et son seul témoin est Anthoine Collot. Jeanne déclare qu’elle n’avait pas conclu de contrat de mariage avec son premier mari.
Les éléments qui me permettent d’avancer que Noël pourrait bien être fils de Christophe Drolet et de Jeanne Levasseur sont:
- Son prénom, Noël, qui est celui de son grand-père Levasseur
- Son métier, maître passementier boutonnier, le même que son père Christophe et que son grand-père Christophe
- Son adresse, il vit dans la rue Guérin Boisseau, comme ses parents et grands parents
- La présence d’Anthoine Collot comme subrogé tuteur de Marguerite Droley et comme témoin de Jeanne Feusché lors de la signature de son contrat de mariage. A cette occasion, Anthoine Collot est qualifié de cousin de la future épouse. On avait justement rencontré Anthoine Collot lors du contrat de mariage d’Anthoine Tharizien et de Marguerite Françoise Le Roy. Il était l’époux de Françoise Hatté, cousine germaine de Jeanne Levasseur. Noël Droley, époux de Jeanne Feusché, était donc effectivement petit cousin d’Anthoine Collot.
Notes :
(1) Dans mes retranscriptions d’actes, je respecte l’orthographe originale, je développe les abréviations, et j’ajoute les accents et la ponctuation pour rendre les textes plus lisibles.
(2) Archives Nationales de Paris, Registre des tutelles Y//3954A, consulté sur le site Familles Parisiennes
(3) AN de Paris, minutes du notaire Nicolas Périer, MC/ET/II/234, consulté sur le site Familles Parisiennes
(4) AN de Paris, minutes du notaire Etienne Thomas, MC/ET/LVII/89
(5) AN de Paris, minutes du notaire Martin Prieur, MC/ET/LII/12
(6) AN de Paris, minutes du notaire Antoine Hurel, MC/ET/L/205